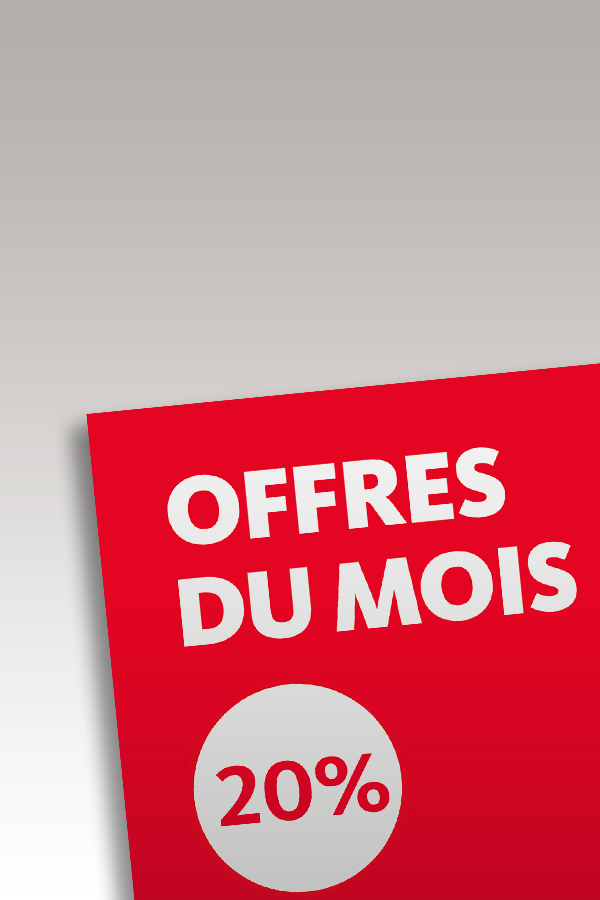Les vacances dans les zones humides de la planète ou dans des pays où le traitement des eaux n’est pas optimal demandent un certain degré de préparation. Le Docteur Gilles Eperon, expert en médecine tropicale, nous livre ses conseils.
Docteur Gilles Eperon, quels sont les risques que présentent les voyages dans les pays tropicaux?
Dr. Gilles Eperon: Lorsque l’on voyage dans une zone tropicale ou subtropicale, le traitement des eaux usées n’est potentiellement pas optimal. Par conséquent, en consommant de l’eau, une personne peut être infectée par des maladies virales comme l’hépatite A, bactériennes comme la «turista» ou encore parasitaires, comme les amibes. Il est également fréquent d’être contaminé par des aliments lavés avec une eau souillée, si ceux-ci ne sont pas cuits. Enfin, dans ces zones, on trouve les maladies vectorielles, transmises par un vecteur, généralement des insectes, comme les moustiques. La malaria est l’exemple le plus connu et fréquent.
Comment se prémunir contre de telles affections?
G. E.: Dans une consultation pré-voyage, comme au Centre de médecine tropicale des Hôpitaux Universitaires de Genève, on propose des vaccinations et des traitements préventifs. On peut également se rendre chez son médecin, mais certains vaccins, comme celui de la fièvre jaune, par exemple, sont limités à certains centres ou médecins spécialisés. Les conseils et les vaccinations proposées diffèrent selon le risque et par conséquent le lieu, la durée et les conditions du voyage. Ainsi, avant un voyage hors du monde occidental, alors que le vaccin contre l’hépatite A est généralement recommandé quelle que soit la destination, la vaccination contre la fièvre typhoïde ne le sera pas forcément.
Quelles sont les règles de base?
G. E.: Lors de nos consultations, nous vérifions et proposons de faire un rappel, si nécessaire, de toutes les vaccinations de base comme la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la rougeole, la rubéole et les oreillons. Hormis la vaccination contre l’hépatite A, d’autres vaccins sont conseillés pour certaines destinations, comme la fièvre jaune, l’hépatite B, la fièvre typhoïde, la méningite épidémique, la rage, ou encore l’encéphalite japonaise ou l’encéphalite à tiques. Certaines vaccinations nécessitent plusieurs injections dans le mois, raison pour laquelle nous conseillons aux voyageurs de se renseigner suffisamment à l’avance, un mois au minimum, voire trois mois pour les personnes sous traitement immunosuppresseur, chez qui les vaccins sont moins performants et qui nécessitent une prise en charge différente.
Quelles sont les précautions à prendre dans les zones chaudes et humides?
G. E.: La maladie à craindre dans ces zones est la malaria. En fonction de la destination, on va recommander la prise d’une «chimio-prophylaxie», un traitement préventif pour éviter la maladie. La région à plus haut risque est l’Afrique subsaharienne et pour un tel voyage, un traitement chimio-prophylactique à prendre avant, pendant et après le voyage est fortement conseillé. Dans les régions à risque plus faible, un traitement de réserve est préconisé. Il faudra emporter le traitement avec soi, à prendre en cas de fièvre seulement si l’on ne peut pas consulter de médecin rapidement. La malaria peut encore se déclarer dans le mois qui suit le retour, par conséquent, il ne faut pas banaliser une fièvre au retour du voyage. La liste des pays à haut risque se trouve sur le site www.safetravel.ch. Il indique aussi quel vaccin est recommandé selon le pays.
Quelles sont les autres maladies que l’on peut contracter par simple piqûre?
G. E.: La dengue, le chikungunya et le virus Zika sont tous les trois transmis par un moustique. Mais ce sont essentiellement des moustiques urbains diurnes, un petit point d’eau leur suffit (un récipient ou un bac à fleurs), contrairement au moustique nocturne qui transmet la malaria, qui est une pathologie rurale. En Asie et en Amérique latine, la dengue est plus fréquente que la malaria. Le Zika est surtout dangereux pour les femmes enceintes, il n’a pas de conséquences majeures pour les autres personnes.
Quels sont les autres risques au bord de l’eau?
G. E.: On peut contracter un parasite par contact, la larva migrans en marchant pieds nus sur la plage. Sur terre, les gens peuvent s’infecter par l’anguillulose. C’est l’un des rares parasites qui peut entraîner des complications si les gens ont peu de défenses immunitaires. Enfin, il faut éviter de se baigner dans l’eau douce en région tropicale, à cause du risque de bilharziose ou schistosomiase. Ces parasites peuvent vivre des années dans le corps humain.
Qu’en est-il sous l’eau?
G. E.: En mer on peut être piqué par des méduses. La consigne est de tremper le membre touché dans l’eau très chaude, car le venin est thermolabile et se dégrade avec la chaleur. Les produits acides comme le vinaigre ont le même effet. Dans les régions tropicales, attention au poisson-pierre ou au poisson-scorpion! Là encore, il faut tremper son pied dans une eau à 40°C. Il existe aussi des coquillages de type cône, très venimeux, qu’il faut éviter de prendre avec les doigts. Enfin, dernière consigne: si l’on se blesse sur un caillou ou un corail, il est nécessaire de bien désinfecter la plaie, car l’eau de mer est un véritable bouillon de culture.

Propos recueillis par :
Judith Monfrini | Contenu & Cie
[layerslider id= »2″]